De Laelia Benoit, aux éditions Seuil .
D’emblée, je suis séduite par les mots de Laela Benoit, cette pédopsychiatre et sociologue.
L’autrice définit l’infantisme comme un « ensemble de préjugés systématiques, de stéréotypes, envers les enfants et les adolescents. » Elle cite également la psychanalyste américaine E. Young-Bruel qui définit l’infantisme comme : « un préjugé envers les enfants fondé sur la croyance qu’ils appartiennent aux adultes et qu’ils peuvent (voire qu’ils doivent) être contrôlés, asservis, ou supprimés pour servir les besoins des adultes. ». La notion d’infanstisme a émergé aux Etats-Unis dans les années 1970. Certaines personnes avancent que les enfants d’aujourd’hui sont choyés, peut-être même en excès. Mais l’autrice explique qu’on peut aimer les enfants tout en ayant des préjugés négatifs. Ceux-ci sont tellement ancrés dans notre culture que les manifestations de ce dénigrement passent inaperçues. Elle prend en exemple les femmes qui ont été valorisées tout en étant enfermées dans leur rôle de mère, à la fois « sainte, courageuses, sacrificielles, des reines dans leur cuisine. »
Laela Benoit s’appuie sur les travaux d’ E. Young-Bruel pour expliquer les trois formes d’infantisme :
1/ l’infantisme narcissique qui s’ancre dans la peur de décliner face à un enfant de plus en plus fort. Le parent va alors considérer et façonner l’enfant comme un prolongement de lui-même. L’enfantisme narcissique peut faire tenir des propos tels que « de mon temps, les enfants éteint (sages, travailleurs, obéissants) », « A ton âge, je faisais déjà (compléter par une activité sans tenir compte de l’évolution des lois relatives au travail ou du contexte économique : travailler, gagner de l’argent) ». L’adulte méprise l’enfant non conforme à ses attentes, et s’il n’est pas le sien, il s’empresse de critiquer ses parents.
2/ l’infantisme hystérique qui consiste à considérer les enfants et adolescents comme des ressources à exploiter. Cela se manifeste par une inversion des rôles : on attend du jeune qu’il prenne soin de ses parents.
3/ l’infantisme obsessionnel considère les enfants comme des parasites qui vident les adultes de leur énergie. En France, cet infantisme se manifeste bezaucoupà travers l’humour : « Mais si on ne peut même plus vivre… ». L’autrice fait le parallèle avec l’humour misogyne qui a longtemps lié les hommes.
L’autrice s’attarde sur l’inaction climatique qu’elle dénonce comme un abus contre la jeunesse. Son équipe et elle ont analysé le traitement médiatique de l’engagement climatique des enfants et des adolescents par la presse américaine. Cette analyse met en évidence différents discours péjoratifs. Certains médias s’indignent que ces jeunes manifestent au lieu d’être en classe. D’autres caricaturent les enfants et adolescents en les décrivant comme es victimes totalement passives du dérèglement climatiques, sans pour autant leur accorder un droit d’action sur leur avenir. Laela Benoit démontre comment les médias s’appuient sur leur statut d’adolescents pour décrédibiliser leurs actions militantes. Ainsi, la matinale de France Culture du 11 septembre 2020 énonce : « L’action en justice menée par des adolescents australiens entre l’expansion d’une mine de charbon. Huit jeunes, de 13 à 17 ans- qui ne sont pas sans rappeler l’activisme de Greta Thunberg- à l’heure où leur principale préoccupation devrait être la couleur de leur trousse et non celle de leur planète, ces jeunes attaquent un projet destiné à être développé dans le sud-est du pays. ». L’autrice imagine un commentaire fictif : « huit femmes ont saisi la justice pour inaction contre les violences sexuelles, à l’heure où leur principale préoccupation devrait être la couleur de leur vernis à ongle. » cela vous parait choquant ? c’est ce que l’on fait vivre aux enfants et aux adolescents. »
L’autrice propose plusieurs pistes pour sortir de l’infantisme :
- Elle insiste sur la nécessité d’éduquer aux émotions. Les adultes devraient être capable de recevoir et d’accompagner les plus jeunes dans leurs émotions, sans chercher à les faire taire, ni par la menace (« arrête de pleurer sinon tu vas dans ta chambre ») ni par la distraction.
Permettre à l’enfant d’avoir conscience de ses émotions devrait progressivement le conduire à la capacité de s’écouter, à prendre soin de ses besoins, de lui-même. Laela Benoit élargit cette capacité de prendre soin de la planète.
- L’autrice propose de donner le droit de vote dès la naissance afin que ceux-ci fassent entendre leur voix comme tout citoyen. A ceux qui retorquent que les enfants seraient instrumentalisés, elle répond que cet argument était semblable lorsqu’il a été question d’accorder le droit de vote aux femmes. D’ailleurs, le risque n’est-il pas identique pour les personnes âgées qui sont dépendantes et votent jusqu’à leur mort ?
- Elle milite pour une parentalité choisie et souhaite que soit mis un terme à la politique de natalité. Chaque individu devrait avoir le choix de devenir parent ou pas, sans pression sociétale. Cette parentalité choisie permettrait de limiter les frustrations qui peuvent amener à se défouler sur les enfants.
- Enfin, Laela Benoit propose de valoriser les métiers de l’enfance.
J’ai essayé d’être aussi fidèle que possible au livre. J’espère surtout vous avoir donné envie de lire le livre. Petit de prix, de taille, il est riche d’enseignement !
Quelques phrases :
« Pourquoi les adultes s’autorisent-ils à dénigrer, moquer, discréditer quotidiennement la parole des enfants et des adolescents ? Qu’auraient-ils à perdre s’ils les prenaient au sérieux ? la vérité qui sort de la bouche des enfants nous ferait-elle si peur ? »
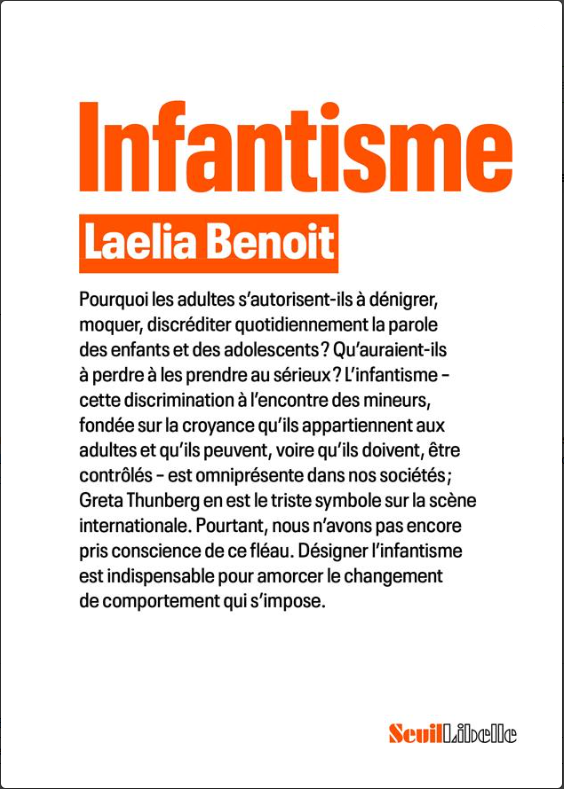
Laisser un commentaire